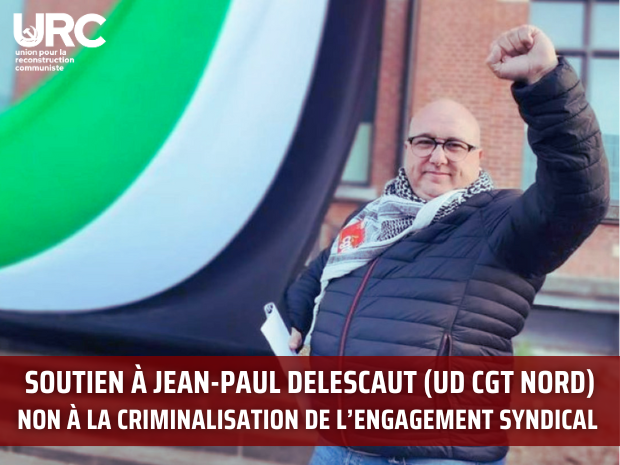Quand l’austerité se déguise en compassion
Depuis plusieurs mois est en débat au Parlement une loi « Fin de vie », scindée ensuite en deux lois (sur les soins palliatifs d’un côté, sur « l’aide à mourir » spécifiquement de l’autre). Elles devaient être votées au Sénat cet automne mais leur examen a été reporté, face aux urgences budgétaires, ce qui pourrait d’ailleurs relancer l’option présidentielle d’en passer par référendum.
L’URC alerte la population sur le contenu réel de ces textes qui ne sont pas aussi « progressistes » que d’aucuns l’affirment.
Ne laissons pas ce sujet aux experts et intervenons !
Un faux problème, de vraies urgences
Depuis la loi Claeys-Léonetti de 2016, un cadre législatif est censé garantir l’accès aux soins palliatifs, mais aussi le droit au refus de traitement, l’interdiction de l’obstination déraisonnable et la possibilité d’une sédation profonde jusqu’au décès.
L’actuel projet de loi sur « l’aide à mourir » n’est pas une avancée, il apparaît déconnecté du droit aux soins palliatifs et « l’aide à mourir » n’est plus clairement cantonnée à la fin de vie.
Le vrai problème n’est pas juridique, mais matériel : 50% des patients qui ont besoin de soins palliatifs n’y accèdent pas, et 21 départements en sont totalement dépourvus. Selon la Cour des comptes, au moins 180 000 personnes en fin de vie sont privées de cet accompagnement chaque année.
Les Français l’ont compris : seuls 8% d’entre eux considèrent ce sujet prioritaire. L’urgence réelle, c’est la restauration du système de soins, pas la légalisation de l’euthanasie.
Une loi qui cible bien au-delà de la fin de vie
Cette loi ne concerne pas uniquement les personnes en fin de vie. Les critères retenus – affection « grave et incurable » en « phase avancée », souffrance physique ou psychologique – sont suffisamment flous pour inclure une large part de la population handicapée et malade chronique. Une personne diabétique avec complications, paraplégique ou atteinte de sclérose en plaques pourrait être éligible à l’aide à mourir.
Cette loi ne relève pas de l’euthanasie au sens strict — réponse ultime à des souffrances insupportables malgré tous les soins disponibles — mais du suicide assisté. Une personne peut demander à mourir sans avoir bénéficié d’un accompagnement en soins palliatifs, sans avoir épuisé les options de soulagement existantes. Le texte permet qu’un tiers administre la substance létale alors que la personne pourrait physiquement le faire elle-même, limitant ainsi la possibilité de rétractation au dernier moment.
L’austérité déguisée en compassion
Le volet sur les soins palliatifs promis par la loi ne change rien aux problèmes budgétaires du secteur. Il crée un « droit opposable » sans moyens réels – rappelons l’échec du droit opposable au logement.
Pire encore : la dernière version du texte remplace l’obligation de proposer activement les soins palliatifs par une simple information conditionnelle (le patient « peut » en bénéficier), et supprime le contrôle de leur accès effectif. L’aide à mourir devient ainsi une alternative assumée à l’obligation pour l’État de garantir l’accès aux soins palliatifs. Cette modification ne protège pas la liberté, elle sert les politiques d’austérité.
Dans le même temps, les personnes handicapées vivent dans une précarité alarmante : près de 20% vivent sous le seuil de pauvreté, 56% ne peuvent faire face à une dépense imprévue de 1000 euros, et le gouvernement envisage de remettre en question la prise en charge des affections longue durée. Comment parler de « libre choix » quand des personnes sont poussées vers la mort par l’impossibilité matérielle de vivre dignement ?
L’ONU elle-même a alerté la France : en 2021, ses experts ont affirmé que « le handicap ne doit jamais être une justification pour autoriser une aide médicale à mourir ». Ils ont mis en garde contre des législations qui « banalisent l’idée que les personnes vivant avec un handicap ont des vies intrinsèquement moins dignes » et ont insisté sur la nécessité d’investir dans des politiques de soutien plutôt que d’offrir la mort comme échappatoire à la marginalisation.
Un délit d’entrave à sens unique
Le texte crée un délit d’entrave puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour quiconque tente de dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, y compris par « la diffusion d’allégations de nature à induire en erreur ».
Cette disposition crée une asymétrie inquiétante : il est illégal de dissuader quelqu’un, mais l’amendement visant à créer un délit d’incitation à l’aide à mourir a été entièrement rejeté. Les personnes placées en institution de long séjour ne bénéficient d’aucune protection particulière : Le responsable d’établissement ne peut empêcher l’aide à mourir dans son établissement, et essayer de dissuader ces personnes devient illégal.
Les leçons du Canada
L’exemple canadien déjà appliqué, dans le même flou que le projet de loi français, est glaçant. Depuis l’élargissement du programme MAiD aux maladies et handicaps non terminaux en 2021, l’euthanasie est devenue plus accessible que les soins : un homme qui ne voulait pas mourir a obtenu l’euthanasie parce qu’il perdait son logement, une ancienne paralympienne s’est vu proposer le MAiD comme alternative à l’installation d’une rampe d’accès attendue depuis cinq ans, des patients ont été rappelés en 24 heures pour leur demande d’euthanasie alors qu’ils attendaient des mois pour des soins palliatifs.
Notre position
Nous dénonçons cette offensive de classe déguisée en progrès des droits humains. Cette loi institutionnalise un tri social où certaines vies sont jugées moins dignes d’être soutenues par la collectivité.
Le capitalisme néolibéral détruit méthodiquement les services publics, précarise les malades et les handicapés, puis leur propose la mort comme « solution compassionnelle » à la misère qu’il a lui-même organisée. Ce n’est pas un droit, c’est une politique d’austérité maquillée en humanisme.
Notre combat porte sur l’opposition ferme à cette loi et la défense d’un système de santé public, gratuit et accessible, de logements adaptés, de revenus suffisants pour vivre et non survivre, d’un accompagnement digne des personnes âgées, des malades et des handicapés et d’un développement massif des services de soins palliatifs sur tout le territoire avec l’application réelle du cadre législatif existant.