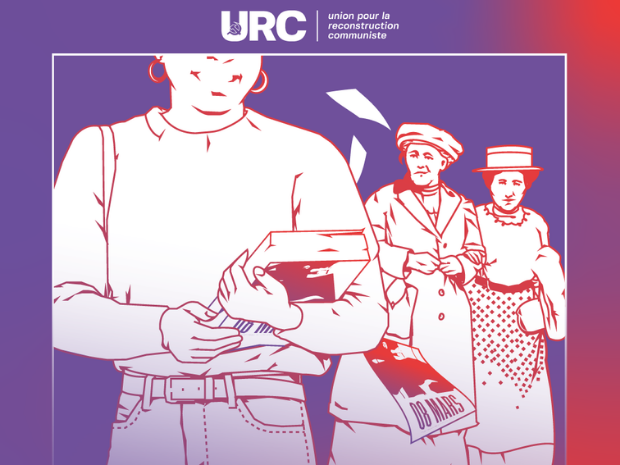Par Dalal, militante URC
Le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) à l’égard des femmes, nous rappelle l’urgence d’aborder les VSS non seulement comme des problèmes individuels, mais surtout comme des manifestations d’une dynamique de pouvoir enracinée dans les structures économiques et sociales.
Dans cette perspective, une analyse matérialiste peut éclairer les relations complexes entre les classes sociales, les violences de genre et le fémonationalisme.
Violences sexistes et classes sociales
Les violences sexistes et sexuelles ne touchent pas toutes les femmes de la même manière : elles constituent une violence systémique qui ne faiblit pas, présente dans les foyers, dans les espaces de sociabilité, au travail, et souvent perpétrée par des proches.
Les femmes issues des classes populaires, les femmes racisées ou vivant dans des conditions précaires, ainsi que les personnes trans et autres minorités de genre, sont exposées à des violences plus brutales et plus constantes, qu’il s’agisse de violences domestiques touchant également les enfants et les adolescent·es, d’agressions sexuelles ou de viols.
Le capitalisme, en tant que système d’exploitation, renforce ces inégalités structurelles, qui sont elles-mêmes exacerbées par le patriarcat et le racisme. Les conditions de vie précaires augmentent la vulnérabilité, que ce soit dans la sphère familiale, au travail ou dans l’espace public.
Les travailleuses précaires, souvent employées dans des secteurs à bas revenus, subissent des abus sexuels et du harcèlement, tout en ayant peu de recours en raison de leur statut économique. Cette marginalisation est renforcée par une justice de classe et raciste : les plaintes sont fréquemment classées sans suite, la police refuse de prendre en charge nombre de témoignages, et les dispositifs de protection restent largement inaccessibles aux femmes précaires et racisées ainsi qu’aux minorités de genre.
De nouvelles formes de violences — comme le revenge porn (pornodivulgation ou vengeance pornographique) ou le catfishing (ou cyber imposture) — touchent particulièrement les jeunes ces dernières années. Si des mobilisations comme #MeToo ont permis de mettre en lumière l’ampleur du phénomène, elles ne l’ont pas endigué pour autant.
Dans ce contexte, les travailleuses racisées et précaires — ainsi que les minorités de genre — occupent par ailleurs une place centrale dans le travail reproductif, souvent pour des femmes plus privilégiées, ce qui illustre de manière concrète l’imbrication des rapports de classe, de race et de genre.
Cette réalité souligne la nécessité d’une approche intersectionnelle et matérialiste qui reconnaît que la lutte contre les violences de genre doit intégrer simultanément la lutte contre les inégalités économiques, l’exploitation du travail reproductif et les logiques racistes du capitalisme patriarcal.
Les femmes en temps de guerre
Les violences sexistes et sexuelles prennent une dimension encore plus tragique en temps de guerre. Dans des guerres de domination coloniale comme en Palestine occupée, au Soudan, ou en République démocratique du Congo, les femmes sont souvent ciblées en raison de leur genre. Les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre pour humilier, contrôler et détruire les communautés.
Les viols collectifs, les abus et les violences physiques deviennent des stratégies systématiques visant à déstabiliser les populations et à maintenir le pouvoir.
Ces violences sont souvent marginalisées dans le discours des féministes bourgeoises, alors qu’il est impératif qu’elles soient intégrées dans notre compréhension des conflits et de l’oppression des femmes.
Les femmes qui vivent dans ces contextes de brutalité coloniales sont non seulement confrontées à la violence physique des criminels, mais elles subissent également les conséquences de la précarité économique exacerbées par le contexte de génocide et de famine qu’elles endurent, souvent complètement désarmées et impuissantes.
Elles sont souvent considérées comme des « victimes collatérales » alors qu’elles subissent les pires exactions. Notre rôle est de pointer le silence autour de ses résistantes aux guerres patriarcales impérialistes et de souligner la nécessité d’une lutte féministe qui inclut une analyse des conflits armés et de leurs impacts sur les femmes.
Fémonationalisme : une instrumentalisation politique
Le concept de fémonationalisme, qui désigne l’utilisation du féminisme à des fins nationalistes, mérite également d’être examiné au prisme de la lutte des classes.
Dans de nombreux pays, les discours sur la protection des femmes, qui semblent promouvoir l’égalité des sexes, sont souvent utilisés pour justifier des politiques d’exclusion et de xénophobie. Les élites politiques peuvent instrumentaliser les violences faites aux femmes pour renforcer un sentiment nationaliste, en présentant les femmes issues de la colonisation ou les minorités comme des menaces à la sécurité des femmes bourgeoises.
Ce phénomène crée une dichotomie qui oppose « les femmes de notre nation » et « les autres », masquant ainsi les inégalités de classe au sein même de la société. Les femmes de classe ouvrière, quelles que soient leurs origines, se retrouvent souvent au bas de l’échelle, mais il est plus facile pour les discours dominants de faire diversion et de se concentrer sur une « autre » qui serait responsable des violences, plutôt que de s’attaquer aux racines économiques et structurelles du problème.
Vers une lutte collective et inclusive
Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il est crucial d’adopter une approche qui lie la lutte des femmes aux luttes de classe. Cela implique de créer des alliances entre les différentes couches de la société, en reconnaissant que les femmes de toutes origines doivent se battre ensemble contre l’oppression.
De plus, il est essentiel de critiquer et de déconstruire le fémonationalisme qui divise et affaiblit le mouvement féministe en France et partout ailleurs dans les pays du Nord.
En conclusion, la journée du 25 novembre doit être un appel à l’action pour toutes les femmes et tous les alliés, afin de dénoncer non seulement les violences sexistes et sexuelles, mais aussi les structures économiques qui les perpétuent.
Un véritable changement de système ne peut se produire qu’à travers une lutte collective qui vise à abolir toutes les formes d’exploitation et d’oppression, en plaçant les voix des femmes de classe ouvrière au cœur de cette dynamique.
C’est ainsi que nous pourrons espérer construire un avenir où toutes les femmes, indépendamment de leurs origines ou de leur statut social, pourront vivre en sécurité et en dignité, même dans les contextes les plus difficiles.
À l’URC, nous nous inscrivons dans une lutte internationaliste pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes sans distinction d’origine ou de couleur, pour des conditions dignes et une justice sociale pour tous.
Nous rendons, à l’occasion de cette journée, un hommage spécifique à nos camarades palestiniennes qui subissent, depuis plus de deux ans, un génocide abominable perpétré par un cartel d’États criminels, complices d’une entité coloniale sioniste ensauvagée, agissant en toute impunité et sans aucune limite, grâce à la complicité de ses bailleurs de fonds atlantistes impérialistes.